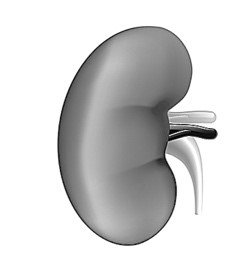 L'échographie fœtale permet la détection de très nombreuses anomalies fœtales. Parmi les plus fréquemment détectées figurent les uropathies, évoquées sur des anomalies du parenchyme rénal ou une dilatation du système urinaire fœtal. Elles concernent 1% à 4,5% de toutes les grossesses.
L'échographie fœtale permet la détection de très nombreuses anomalies fœtales. Parmi les plus fréquemment détectées figurent les uropathies, évoquées sur des anomalies du parenchyme rénal ou une dilatation du système urinaire fœtal. Elles concernent 1% à 4,5% de toutes les grossesses.
Le dépistage des uropathies permet d’adapter la prise en charge néonatale avec en priorité le diagnostic des valves de l’urètre postérieur, qui nécessitent un traitement chirurgical en urgence dès la naissance. De rares indications de drainage peuvent également être posées pour une obstruction complète de la jonction pyélo-urétérale ou pour un reflux vésico-urétéral de haut grade. La majorité des uropathies ne nécessiteront pas d’intervention chirurgicale, et les différentes études indiquent qu'entre 65 % et 95 % des patients concernés par un diagnostic prénatal d’uropathie ne présenteront finalement pas d'anomalie urologique significative en post-natal. La gestion prénatale et le conseil adaptés ont pour but de réduire le stress des futurs parents, d’adapter au mieux le lieu d’accouchement et d’éviter des examens non pertinents ou de préparer la naissance dans une maternité où des examens et un geste chirurgical seront possibles.
 La prise en charge prénatale est dans la très grande majorité attentiste, basée sur une surveillance échographique de l’évolution des différents paramètres morphologiques et un contrôle de la bonne vitalité fœtale. Les indications d’interruption de grossesse sont exceptionnelles, réservées aux insuffisances rénales terminales, toujours sur des atteintes bilatérales : agénésie, dysplasie multikystique ou valves de l’urètre postérieur. Les indications de drainage du bassinet ou de la vessie sont discutées en centre expert, compte tenu d’une balance bénéfices-risques qui reste complexe.
La prise en charge prénatale est dans la très grande majorité attentiste, basée sur une surveillance échographique de l’évolution des différents paramètres morphologiques et un contrôle de la bonne vitalité fœtale. Les indications d’interruption de grossesse sont exceptionnelles, réservées aux insuffisances rénales terminales, toujours sur des atteintes bilatérales : agénésie, dysplasie multikystique ou valves de l’urètre postérieur. Les indications de drainage du bassinet ou de la vessie sont discutées en centre expert, compte tenu d’une balance bénéfices-risques qui reste complexe.
L'analyse du liquide amniotique, principalement produit et maintenu par la diurèse fœtale, constitue un indicateur crucial de la fonction rénale. L'oligoamnios est un facteur prédictif négatif d'insuffisance rénale et de décès néonatal. L'âge gestationnel d'apparition de l'oligoamnios est un élément important de la prédiction du risque de mortalité périnatale.
L’étude de la morphologie rénale est systématique. L'épaisseur et l'aspect parenchymateux rénal font l'objet d'une évaluation subjective. Selon la Classification de la Société d'Urologie Fœtale, une réduction de l'épaisseur du rein doit être envisagée lorsqu’elle est réduite de plus de la moitié par rapport à celle du rein normal, ou lorsqu’elle est inférieure à 4 mm. Les voies excrétrices sont également décrites.
Une agénésie rénale peut être facilement identifiable en échographie anténatale, du fait de la vacuité de la loge rénale. Il peut également y avoir un rein ectopique, qui n’est pas toujours visualisable. Une agénésie unilatérale n’aura pas de conséquence fonctionnelle pré ou post-natale. Elle nécessite néanmoins une surveillance post-natale du rein unique, même en l'absence d'une uropathie associée.
Un rein ectopique est un rein situé en dessous, au-dessus ou parfois du côté opposé à la position normale. Les reins d'un fœtus se développent d'abord sous forme de bourgeons dans le pelvis puis migrent dans la fosse lombaire pendant les 8 premières semaines de croissance fœtale. Aucune prise en charge spécifique prénatale n’est à proposer. Une surveillance échographique post-natale annuelle est recommandée pour surveiller la croissance rénale, et l'absence d'autres pathologies associées, qui pourraient nécessiter une surveillance spécifique ou une prise en charge. Le diagnostic de rein en fer à cheval ou sigmoïde reste rare en prénatal et n’a de conséquence que s’il s’accompagne d’une dilatation des voies excrétrices.
La dysplasie multikystique est une destruction complète du parenchyme rénal, qui est remplacé par des kystes, de taille variable. Elle est un équivalent de rein unique. Même en cas de kystes nombreux et volumineux, un effet de masse est exceptionnel et le suivi échographique s’adapte au volume rénal.
Un système rénal double désigne une duplication de la voie excrétrice constituée par une partie du tissu rénal, le bassinet et son uretère, avec les deux uretères s’abouchant dans la vessie. Cette duplication peut entrainer une uropathie en cas d’abouchement anormal des uretères, avec en conséquence un reflux vésico-urétéral, un méga-uretère, une urétérocèle ou un pôle rénal dysplasique et non fonctionnel. Un système double sans dilatation urétéro-pyélocalicielle ou sans autre anomalie ne nécessitera pas de surveillance spécifique après la naissance et est à considérer comme une variante de la normale.
Les voies excrétrices sont normalement non visibles en échographie fœtale. Le terme "hydronéphrose" ou "pyélectasie" désigne une dilatation des cavités pyélo-calicielles: l'hydronéphrose implique une dilatation pathologique et la pyélectasie conserve un sens plus « physiologique ». La seule mesure de référence, tant en anténatal qu'en postnatal est le diamètre antéropostérieur du bassinet (DAP). Le seuil pathologique et donc de surveillance est un DAP > 7 mm au deuxième trimestre et > 10 mm au troisième trimestre. Ngyuen et al. en 2010 ont montré qu’une dilatation était transitoire et considérée comme physiologique dans 50 à 70% des cas. Il reste nécessaire de surveiller l’évolution d’un DAP dilaté. Une dilatation progressive des voies urinaires est le plus souvent associée à une uropathie, qui nécessitera un suivi et peut-être une intervention en post-natal : syndrome de la jonction pyélo-urétérale ou reflux vésico-urétéral massif. La mesure des calices est également importante pour définir le degré de dilatation. Elle est un reflet de la pression dans des cavités rénales et donc du retentissement sur le parenchyme rénal. Son évaluation est subjective, sans valeurs seuils mesurées.
La dilatation de l’uretère peut être le reflet d’une obstruction de la jonction urétéro-vésicale, d’un reflux vésico-urétéral, d’un méga-uretère ou d’un obstacle sous vésical. La dilatation des uretères peut être isolée. Elle est cependant le plus souvent associée à une dilatation des cavités pyélo-calicielles. De ce fait, le risque d'infection urinaire en post-natal est significativement plus élevé lorsqu’il existe une dilatation urétérale. La visualisation des uretères dilatés représente un facteur de risque indépendant des mesures du bassinet.
La vessie fœtale normale effectue un cycle toutes les 30 à 45 minutes in utero. La visualisation du cycle vésical in utero et sa relation avec la dilatation du bassinet sont d'importants facteurs pronostiques des pathologies urologiques postnatales. L'absence de vidange de la vessie après 45 minutes ou la présence d'une vessie distendue peut être le reflet de pathologies sévères comme des valves de l’urètre postérieures ou d’un syndrome de Prune-Belly. Le diagnostic de valves de l’urètre doit toujours être évoqué en cas de grande vessie à paroi épaissies avec une dilatation urétérale, le plus souvent bilatérale mais parfois unilatérale. L’absence de visualisation de la vessie doit faire quant à elle évoquer une exstrophie vésicale. Il n’y a dans ce cas pas d’autre anomalie du système rénal et la quantité de liquide amniotique est normale.
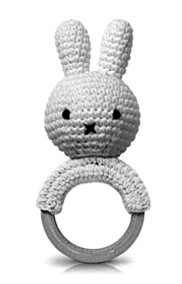 L’échographie reste l’examen de base et de référence du suivi post-natal des uropathies. Elle est à réaliser, sauf situation urgente, après la première semaine afin de permettre la réhydratation du fœtus et la bonne mise en route de la diurèse. Elle est habituellement effectuée au premier mois de vie, associé à la première consultation chirurgicale post-natale. Cette échographie reste basée sur les mêmes critères morphologiques que l’échographie prénatale : taille et position des reins, mesure du diamètre antéro-postérieur du bassinet, évaluation de la dilatation des calices, aspect et épaisseur du parenchyme rénal, mesure du diamètre urétrale, volume/épaisseur et vidange de la vessie. Le rythme des suivis sera décidé à l’issue de cette première évaluation.
L’échographie reste l’examen de base et de référence du suivi post-natal des uropathies. Elle est à réaliser, sauf situation urgente, après la première semaine afin de permettre la réhydratation du fœtus et la bonne mise en route de la diurèse. Elle est habituellement effectuée au premier mois de vie, associé à la première consultation chirurgicale post-natale. Cette échographie reste basée sur les mêmes critères morphologiques que l’échographie prénatale : taille et position des reins, mesure du diamètre antéro-postérieur du bassinet, évaluation de la dilatation des calices, aspect et épaisseur du parenchyme rénal, mesure du diamètre urétrale, volume/épaisseur et vidange de la vessie. Le rythme des suivis sera décidé à l’issue de cette première évaluation.
D’autres examens complémentaires peuvent être prescrits par le médecin spécialiste en fonction de la situation et de l’évolution clinique : urétrocystographie, en cas de recherche de reflux vésico-urétéral ; scintigraphie rénale, pour une évaluation de la fonction (DMSA) ou d’une obstruction (MAG3). L’IRM Fonctionnelle Urologique est un examen non invasif, permettant d'évaluer à la fois la morphologie des reins et la fonction dynamique. Elle est plus difficile à réaliser et est plus particulièrement utile pour des anomalies complexes.
Les dilatations du bassinet de plus de 10 mm à l’échographie du troisième trimestre nécessitent un contrôle après la naissance. Il est habituel qu’une dilatation modérée soit évaluée à un mois de vie et une dilatation unilatérale sévère à une ou deux semaines. Le suivi dépendra ensuite des constatations de la première échographie post-natale. Le diamètre antéro-postérieur du bassinet reste le paramètre le plus utilisé pour déterminer la gravité de la pathologie et le risque d'une uropathie nécessitant une prise en charge chirurgicale. Tous les bassinets dépassant les 40 mm nécessiteront une chirurgie, alors que seuls 10 % des dilatations < 20 mm seront opérés. Si la dilatation dépasse 20 mm, une scintigraphie est habituellement réalisée pour une évaluation fonctionnelle.
Le diagnostic principal est celui d’un syndrome de la jonction pyélo-urétérale, dont les indications opératoires sont une dilatation pyélocalicielle majeure avec un bassinet > 40 mm, un retentissement fonctionnel ou la survenue de symptômes (infection urinaire, douleurs, calculs ou coliques nephretiques).
Echographie d’une dilatation pyélocalicielle modérée

Echographie à 1 mois de vie. A : Bassinet mesuré à 10.3 mm en antéropostérieur. Parenchyme d’épaisseur normale et de différentiation conservée. Uretère non visible en aval. B : Coupe longitudinale confirmant l’aspect normal du parenchyme. Calices visibles mais non dilatés. Une surveillance est proposée en échographie, sans nécessité d’autres examens complémentaires.
Echographie d’une dilatation pyélocalicielle majeure

Echographie à 6 mois de vie. A : Bassinet mesuré à 53 mm en antéropostérieur. Parenchyme aminci mais de différentiation conservée. Uretère non visible en aval. B : Coupe longitudinale montrant la compression du parenchyme parenchyme avec des calices dilatés dits en « boule ». Les explorations seront complétées par une scintigraphie, pour confirmer le retentissement fonctionnel avant une cure chirurgicale.
Le méga-uretère est une cause fréquente de dilatation des voies urinaires de découverte prénatale (environ 10-30%). Il est secondaire à une anomalie de la jonction urétéro-vésicale. Le méga-uretère peut être obstructif non refluant ou obstructif et refluant. La plupart des méga-uretères régressent spontanément dans les premiers 12 mois de vie.
La persistance d’une dilatation urétérale supérieure à 10 mm est un facteur prédictif de prise en charge chirurgicale, avec comme risque principal la survenue d’infection urinaire. Une dilatation inferieure à 10 mm peut être physiologique, secondaire à un reflux d’immaturité ou à une hypotonie résiduelle. Le reflux vésico-urétéral est considéré comme physiologique dans les premiers mois/années de vie.
La prise en charge chirurgicale, si nécessaire, est réalisée le plus souvent après l’âge de 1 an, à la fois du fait de l’évolution favorable de la grande majorité des cas et également pour réduire les risques d’une chirurgie sur une petite vessie. Avant l’âge de 1 an, le but de la prise en charge est de réduire le risque d’infection urinaire, avec l’introduction d’une antibioprophylaxie ainsi que la possibilité de réaliser une posthectomie chez les garçons. Toute dilatation urétérale ou pyélocalicielle bilatérale chez les garçons (de diagnostic anténatal ou postnatal) associée ou non à une anomalie du parenchyme rénal ou de la vessie, nécessite d’écarter le diagnostic de valves de l’urètre postérieur.
Les dysplasies multikystiques restent très majoritairement asymptomatiques. La grande majorité des reins dysplasiques involuent au cours des cinq premières années de vie. Compte tenu du faible risque d'hypertension artérielle secondaire ou d'infection des voies urinaires (avec un risque comparable à celui de la population générale), une prise en charge conservatrice non chirurgicale est toujours proposée initialement. La surveillance est réalisée par des échographies régulières afin de vérifier l'involution du rein et l'absence d'anomalie du rein controlatéral.
Les valves de l’urètre postérieur sont une anomalie congénitale caractérisée par la persistance anormale de replis muqueux dans la lumière de l’urètre entraînant une obstruction en amont, de degré variable. L’incidence varie de 1 : 7 500 naissances vivantes. Dans la forme classique, la plus sévère, l’uropathie se manifeste en prénatal par une dilatation de l’ensemble de l’arbre urinaire en amont de l’obstacle : dilatation de l’urètre postérieure, vessie de grande capacité à paroi crénelée et épaissie, ne se vidant pas durant des examens successifs, dilatation urétérale bilatérale, dilatation pyélique et calicielle. Elle s’associe à une hyperéchogénicité du parenchyme rénal. La prise en charge postnatale doit être faite en milieu spécialisé dans une maternité de niveau 3. Le diagnostic à la naissance doit est confirmé par la réalisation d’une cystographie. Une section endoscopique de la valve est alors réalisée. Dans certains cas particuliers et exceptionnels lorsque la vessie est très altérée, une dérivation urinaire à type de vesicostomie peut être réalisée.
Le suivi à long terme est multidisciplinaire et nécessite une stricte surveillance urologique, du fait de possibles anomalies de la vidange vésicale, et néphrologique compte tenu du risque d’insuffisance rénale.
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
- Radmayr C, Bogaert G, Dogan H et al (2023) Paediatric urology. EAU Guidelines Edn. presented at the EAU Annual Congress Milan 2023.
- Nguyen HT, Phelps A, Coley B, Darge K, Rhee A, Chow JS. 2021 update on the urinary tract dilation (UTD) classification system: clarifications, review of the literature, and practical suggestions. Pediatr Radiol. 2022;52(4):740-751. doi:10.1007/s00247-021-05263-w.
- Schürch B, Manegold-Brauer G, Schönberger H, et al. Diagnostic accuracy of an interdisciplinary tertiary center evaluation in children referred for suspected congenital anomalies of the kidney and urinary tract on fetal ultrasound - a retrospective outcome analysis. Pediatr Nephrol. 2021;36(12):3885-3897. doi:10.1007/s00467-021-05139-z.
- Fontanella F, van Scheltema PNA, Duin L, et al. Antenatal staging of congenital lower urinary tract obstruction. Ultrasound Obstet Gynecol 2019;53:520–524.
- Braga LH, D’Cruz J, Rickard M, et al. The Fate of Primary Nonrefluxing Megaureter: A Prospective Outcome Analysis of the Rate of Urinary Tract Infections, Surgical Indications and Time to Resolution. J Urol. 2016;195:1300–1305. doi: 10.1016/J.JURO.2015.11.049.
- Malin, G., et al. Congenital lower urinary tract obstruction: a population-based epidemiological study. BJOG, 2012. 119: 1455. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22925164/
- Sidhu G, Beyene J, Rosenblum ND. Outcome of isolated antenatal hydronephrosis: a systemic review and meta-analysis. Pediatr Nephrol 2006;21:218–24.
- Lee RS, Cendron M, Kinnamon DD, et al. Antenatal hydronephrosis as a predictor of postnatal outcome: a meta-analysis. Pediatrics 2006;118:586–96.



