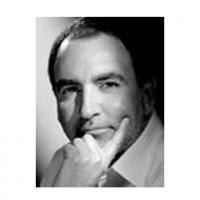L'endométriose est une maladie inflammatoire chronique qui touche environ 10 à 15 % des femmes en âge de procréer, soit entre 1,5 et 2,5 millions de femmes en France. Pourtant, son diagnostic est encore souvent tardif à la suite d’une errance médicale moyenne de sept ans.
Les impacts de l’endométriose sur la santé des femmes sont nombreux. Son effet sur la fertilité est important : 30 à 50 % des patientes prises en charge dans les centres d’Assistance Médicale à la Procréation (AMP) en France sont atteintes d’endométriose. L’absence d’une prise en charge efficace aggrave les difficultés à concevoir naturellement, augmentant ainsi le recours aux traitements d’AMP, dont les coûts financiers et émotionnels sont élevés. De nombreuses femmes doivent renoncer à une maternité à cause d’un diagnostic tardif et du manque d’information sur la préservation de leur fertilité.
Au-delà de la fertilité, l’endométriose est une maladie de la douleur chronique qui altère profondément la qualité de vie des patientes. Les douleurs invalidantes incluent des dysménorrhées sévères, souvent résistantes aux antalgiques classiques, pouvant empêcher de travailler ou de mener une vie normale plusieurs jours par mois. Certaines patientes souffrent de douleurs pelviennes chroniques irradiant vers le dos, les jambes ou la région lombaire. D'autres éprouvent des douleurs lors des rapports sexuels (dyspareunie), ce qui impacte la vie intime et la stabilité du couple. Les symptômes digestifs et urinaires sont également fréquents, avec des troubles du transit (diarrhées, constipation, ballonnements), des douleurs après les repas, des mictions douloureuses et une sensation de pesanteur sur la vessie.
L’endométriose affecte aussi la capacité à travailler. Les patientes subissent un absentéisme fréquent en raison des crises douloureuses et des hospitalisations. Le présentéisme douloureux est également courant : les femmes continuent à travailler malgré la douleur, ce qui réduit leur productivité. Certains métiers deviennent incompatibles avec la maladie, entraînant des difficultés à conserver un emploi stable. La progression professionnelle est également impactée par l’incompréhension de l’entourage professionnel.
Les répercussions sur la santé mentale des patientes sont significatives. L’anxiété et le stress permanent liés à la douleur sont fréquents. Beaucoup souffrent d’épisodes dépressifs dus à l’incompréhension et à la solitude face à la maladie. Certaines patientes développent un syndrome de stress post-traumatique après avoir subi des douleurs extrêmes ou des interventions répétées. La fatigue chronique, exacerbée par des douleurs nocturnes et un sommeil perturbé, aggrave encore la situation.
La prise en charge de la douleur est essentielle, mais reste insuffisante et inégale. Les centres de la douleur ne sont pas accessibles à toutes les patientes.
L’endométriose a également un impact sur la vie sociale et familiale. L’isolement social est fréquent en raison des annulations d’événements et de sorties à cause des douleurs. Les patientes éprouvent des difficultés à expliquer leur maladie à leur entourage, ce qui génère un sentiment d’incompréhension. La vie de couple est affectée par la dyspareunie et par les problèmes de fertilité, qui pèsent sur le projet parental et engendrent une charge émotionnelle importante.
Les répercussions financières de l’endométriose sont lourdes. Les traitements non remboursés (ostéopathie, acupuncture, thérapies complémentaires) ont un coût élevé. Les arrêts de travail fréquents peuvent impacter les revenus et obliger certaines patientes à envisager une reconversion professionnelle.
Une sensibilisation accrue et une amélioration des méthodes diagnostiques permettraient une prise en charge plus précoce. Après le diagnostic, chaque patiente devrait bénéficier d’un parcours de soins coordonné et personnalisé, prenant en compte le suivi médical, le soutien psychologique, la gestion de la douleur et des conseils en fertilité. Une telle approche nécessite une collaboration étroite entre professionnels de santé, associations de patientes et structures de soins.
Sur 100 patientes diagnostiquées, 25 à 30 % seront opérées, dont la moitié pour des formes profondes ou complexes (atteinte du tube digestif, de l’appareil urinaire, des nerfs, du diaphragme). Environ 30 à 40 % auront recours à la FIV. Une prise en charge tardive ou inadéquate réduit les chances de conception naturelle et augmente le recours à la PMA, faisant de l’endométriose un défi démographique dans un contexte de baisse de la natalité . Un nombre significatif de patientes devront envisager une préservation ovocytaire.
Les données épidémiologiques soulignent l’importance d’adapter les stratégies de santé publique à l’endométriose. Une détection précoce, des parcours de soins coordonnés, une prise en charge chirurgicale appropriée, un soutien en fertilité et une gestion efficace de la douleur sont essentiels pour améliorer la qualité de vie des patientes.
Le diagnostic précoce repose sur des critères standardisés : interrogatoire clinique, dépistage des signes précoces, examens d’imagerie adaptés et tests salivaires. La sensibilisation des femmes et des couples à l’impact de l’endométriose sur la fertilité est également indispensable.Le test salivaire devrait ameliorer la précocité du diagnostic et sa pertinence en particulier lorsque l’imagerie n’y parvient pas ou n’est pas accessible.
Après le diagnostic, chaque patiente doit être intégrée dans un parcours de soins multidisciplinaire coordonné.
Les stratégies thérapeutiques doivent être discutées en réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) pour éviter les chirurgies inutiles, proposer des interventions complexes, optimiser les chances de grossesse et améliorer la prise en charge globale.
Depuis 2022, une stratégie nationale mobilisant tous les acteurs a été mise en place. Le Ministère de la Santé et la Direction Générale de l’Offre de Soins (DGOS) pilotent cette initiative. Les Agences Régionales de Santé (ARS) appliquent la stratégie sur le terrain en identifiant les structures compétentes et en réduisant les inégalités d’accès aux soins. Les dispositifs d’appui à la coordination (DAC) et les Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS) assurent la mise en réseau des professionnels de santé.
Les filières endométriose, déployées sur l’ensemble du territoire national, jouent un rôle central dans l’identification d’une cartographie de l’offre de soins sur leur territoire , sa coordination et son animation . Structurées par les ARS elles visent à proposer sur chaque territoire une offre de soins de différents niveaux, à fluidifier les parcours en assurant une meilleure coordination entre les professionnels de santé. Elles regroupent des gynécologues, des radiologues, des chirurgiens, des spécialistes de la douleur, des experts en fertilité ainsi que des associations de patientes, garantissant ainsi une approche multidisciplinaire et adaptée aux besoins spécifiques de chaque femme.
Le premier travail des filières a été d’identifier les centres de niveau 3 ou centres de recours ( plutôt que centres experts ) qui jouent un rôle clé dans la prise en charge des formes complexes d’endométriose. Ils rassemblent des équipes pluridisciplinaires comprenant des chirurgiens gynécologues, des spécialistes de la douleur et des experts en médecine de la reproduction. Leur mission principale est d’assurer une prise en charge adaptée aux patientes souffrant d’atteintes profondes, digestives, urinaires ou nerveuses, nécessitant souvent une approche chirurgicale avancée. En plus des interventions chirurgicales, ces centres coordonnent également la gestion de la douleur et l’accompagnement en procréation médicalement assistée (PMA) pour les femmes dont la fertilité est compromise. Grâce à des Réunions de Concertation Pluridisciplinaire (RCP), les décisions thérapeutiques sont prises de manière collégiale afin d’optimiser les chances de réussite et d’éviter les interventions inutiles. Ces centres de recours représentent ainsi un maillon essentiel dans l’organisation des soins, garantissant aux patientes un suivi médical de haut niveau et une prise en charge globale adaptée à la sévérité de leur endométriose.Le CNGOF et la SCGP ont de leur coté travaillé sur les critères d’accréditation de ces centres dévolus à la prise en charge des formes complexes et des complications . Cependant ces centres ne concernent environs que 15 a 20 % des patientes . 80 % des patientes endométriosiques seront prise en charge ailleurs .
Les filières ont également favorisé la formation et la sensibilisation des professionnels de santé notamment les médecins généralistes et les sages-femmes, pour améliorer le diagnostic précoce et éviter les errances médicales.
Grâce à ces filières, des protocoles de diagnostic et de prise en charge ont été harmonisés, facilitant l’accès aux examens d’imagerie spécialisés et réduisant les délais d’orientation vers des structures adaptées. Même si l’offre de soins est encore insuffisante sur le territoire les filières permettent aux patientes de trouver une solution de preservation de leur fertilité quand elle est necessaire .
Elles ont également œuvré à l’amélioration de la prise en charge de la douleur, en facilitant l’accès aux centres de la douleur et aux thérapies complémentaires (ostéopathie, acupuncture, hypnose).
Enfin, les filières endometrioses ont renforcé la sensibilisation du grand public et des patientes elles-mêmes, en développant des campagnes d’information et en soutenant les associations.
Malgré ces avancées, des défis subsistent, notamment en matière d’égalité d’accès aux soins sur l’ensemble du territoire et de renforcement des moyens dédiés à ces structures.Plusieurs défis persistent. Il existe un manque de professionnels de santé de premier recours . Les parcours de soins manquent encore de clarté et d’une coordination efficace. L’accès aux soins reste inégal selon les régions, avec un nombre insuffisant de centres spécialisés et de délais d’attente prolongés pour des examens clés comme l’IRM pelvienne.
La prise en charge de la douleur dans l’endométriose reste un enjeu majeur. Malgré l’existence de centres spécialisés dans la gestion de la douleur, l’accès à ces structures est encore insuffisant et inégal sur le territoire. De nombreuses patientes se retrouvent sous-traitées avec des antalgiques inadaptés, faute de solutions accessibles. Les approches complémentaires, telles que l’ostéopathie, l’acupuncture ou encore la neurostimulation, bien que bénéfiques, restent peu prises en charge et difficiles d’accès pour une majorité de femmes. Par ailleurs, les centres spécialisés en douleur et endométriose sont saturés, avec des délais d’attente pouvant atteindre plusieurs mois, retardant ainsi une prise en charge adaptée. Cette situation aggrave non seulement les souffrances physiques, mais aussi l’impact psychologique de la maladie, favorisant anxiété et dépression.
La coordination entre spécialistes est encore insuffisante et nécessitera des outils numériques facilitant le suivi médical des patientes et la collaboration interprofessionnelle . Le renforcement de la télémédecine, le développement de l’intelligence artificielle va surement permettre d’ améliorer l’orientation des patientes et la coordination des soins.